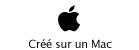Communication

Lewin K.

(1890-1947)
Après avoir fait ses études de psychologie à Berlin dans les années 1910, où régnait alors la psychologie de la Gestalt (ou théorie de la forme), Kurt Lewin devint professeur et chercheur dans cette même université de 1924 à 1935. A l’arrivée du fascisme, K. Lewin, qui est Juif, quitte l’Allemagne en 1935 pour les Etats-Unis. C’est là qu’il réalise de nombreuses expériences sur la motivation, les styles de commandement, la dynamique des groupes. En 1944, il fonde le Research Center for Group Dynamics au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il meurt trois ans plus tard, en 1947. Il a jeté les bases de la psychologie sociale en laissant derrière lui non seulement une œuvre théorique, mais aussi en ayant mis la discipline sur la voie de l’expérimentation et formé de nombreux chercheurs de renom (Leon Festinger, Theodore Newcomb).
La théorie des champs
Notre environnement physique et social constitue pour K. Lewin un « champ de force ». Les objets ou les personnes qui nous entourent sont des objets d’attraction et de répulsion. K. Lewin en donne un exemple simple. Le même paysage n’a pas la même signification pour un promeneur du dimanche qui contemple la nature et pour un chasseur à l’affût du gibier. L’ensemble formé par le sujet (S) et son environnement (E) apparaît comme un « champ » structuré de forces composé de zones d’attraction et de répulsion. Cette théorie du « champ » est inspirée à K. Lewin par la théorie de la Gestalt, mais aussi par la physique théorique qu’il suit avec intérêt.
K. Lewin aimait formaliser les champs de force ou espace de vie dans lesquels vit un individu sous forme de schémas. Par exemple, un individu boulimique désire fortement ouvrir son placard pour y prendre un paquet de gâteaux. Notons que la motivation de l’individu est animée seulement par un besoin physiologique (la faim), mais l’attraction se manifeste d’autant plus que le paquet est à portée de main (la motivation est donc dépendante de l’environnement). Le sujet résiste cependant à la tentation, car il s’est promis de maigrir et, surtout, il y a une autre personne dans la pièce qui ne manquera pas de lui reprocher son attitude de laisser-aller s’il prend le paquet. Il existe donc un conflit entre les forces d’attraction et les résistances, les obstacles pour parvenir au but. Ces différentes forces peuvent être représentées, comme en physique, par des zones A, B et C de l’environnement, qui ont chacune une valeur subjective différente, ou des vecteurs qui représentent des forces d’attraction et de répulsion qui augmentent ou non en fonction de la proximité du sujet (comme pour les pôles d’un aimant).
La théorie des champs s’applique aussi aux groupes humains : une classe, un service dans une entreprise, une bande de jeunes, etc. On conçoit qu’il existe entre les personnes des phénomènes d’attraction et de répulsion comparables à des champs de forces. Le but de la dynamique des groupes sera donc, selon K. Lewin, d’étudier explicitement des champs de forces à l’intérieur des petites communautés humaines. C’est dans ce but qu’il crée le Research Center for Group Dynamics au mit en 1944.
Les trois styles de leadership
Dans une expérience célèbre, réalisée à la fin des années 30, K. Lewin et ses collègues, Ron Lippitt et Robert W. White, ont cherché à mesurer l’influence d’un type de direction sur un groupe de jeunes garçons de 10-11 ans. L’expérience consiste à former trois groupes dirigés respectivement par un leader de style autoritaire (il est directif, n’écoute pas les suggestions du groupe et prend les décisions seul), un leader de style démocratique (qui écoute le groupe, propose plus qu’il ne commande, suscite l’accord et l’adhésion du groupe) et enfin un leader de style laisser-faire (qui intervient très peu, se contentant au besoin de donner des conseils). Ayant confrontés ces trois groupes à une même tâche, les auteurs s’attendaient à ce que le style démocratique soit le plus performant. En fait, les résultats sont plus contrastés. Le style autoritaire est aussi efficace que le style démocratique pour accomplir une tâche confiée au groupe. Le style laisser-faire est le moins performant. En revanche, dans le groupe démocratique, la satisfaction est la plus grande. Lorsque le leader est absent, le groupe à direction démocratique s’avère plus performant, alors que l’efficacité du style autoritaire s’effondre.
K. Lewin a été un des premiers à mettre en œuvre l’expérimentation en psychologie sociale, mais il est aussi un théoricien convaincu. Il a défendu une approche à la fois théorique et expérimentale. On lui attribue souvent cette formule : « Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie. » Esprit progressiste, il était aussi très soucieux de l’utilité sociale de la recherche en psychologie sociale.
La dynamique de groupe
Un groupe n’est pas une simple juxtaposition d’individus mais une « totalité dynamique » qui résulte des interactions entre ses membres, des phénomènes d’attraction et de répulsion, des conflits de forces. Chaque groupe possède donc son champ dynamique avec ses canaux de communication, ses frontières, ses barrières. Toute information nouvelle n’est acceptée que dans la mesure où elle s’intègre dans le « champ » du groupe.
Une des recherches les plus célèbres à ce sujet a été menée par K. Lewin en 1943. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain cherchait à faire consommer aux ménagères des abats (cœur, tripes, rognons) plutôt que de la viande de premier choix. Un échantillon de femmes fut divisé en plusieurs groupes : à certaines, on fit écouter une conférence sur l’intérêt des abats dans le cadre d’une économie de guerre, à d’autres une conférence sur les bienfaits alimentaires des abats. On fit participer d’autres groupes à des discussions collectives, soit sur le thème de l’économie de guerre, soit sur les bienfaits des abats. On constata qu’au bout d’une semaine, seulement 3 % des femmes qui avaient assisté aux conférences avaient changé leurs habitudes alimentaires, alors que le tiers de celles qui avaient participé aux discussions de groupes avaient modifié leurs achats. L’efficacité du message dépendait ici de la forme de communication utilisée.
Principaux ouvrages de K. Lewin
*A Dynamic Theory of Personality, 1935; trad. fr.: Psychologie dynamique : les relations humaines, 1965*Principles of Topological Psychology, 1936*Authority and Frustration, 1944
samedi 26 février 2011